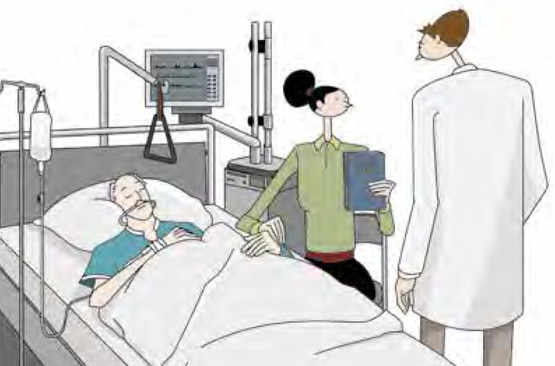Moins de tracasseries pour les proches

C’est un progrès pour les conjoints et les proches de patients frappés d’une incapacité de discernement: dès le 1er janvier 2013, leur autorité est reconnue d’office par les nouvelles dispositions du code civil. Et pour bien comprendre ce qui va changer, un exemple vaut mille explications. Examinons le cas de M. et Mme Dubois.
A l’automne de leur vie, ils égrènent des jours paisibles dans la douceur d’un mariage long de plusieurs décennies. Elle, encore vive, s’occupe de la maison. Lui décline lentement, mais de façon inquiétante. Un jour, le verdict tombe: Alzheimer. Deux ans plus tard, le médecin de famille suspecte chez M. Dubois une tumeur cérébrale. Le seul moyen d’en avoir la certitude est de procéder à une biopsie. Mais vu l’âge et l’état du patient, le neurochirurgien refuse l’opération. Mme Dubois insiste: elle le connaît par cœur son mari: il n’aurait pas hésité une seconde à prendre le risque de l’opération.
Le hic, c’est que son mari, désormais incapable de discernement, n’a jamais rédigé de directives anticipées. Il n’a donc pas exprimé ses volontés noir sur blanc, ni désigné formellement un représentant thérapeutique. Dès lors, qui peut prendre la décision de lui donner les soins requis? Le chirurgien ou l’épouse?
Avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, seule une décision de justice aurait pu donner à Mme Dubois le titre de représentant thérapeutique et donc la compétence de prendre cette décision. Dès 2013, à défaut d’un curateur ou d’une personne désignée par directives anticipées, le conjoint ou le partenaire enregistré, s’il fait ménage commun ou s’il fournit une assistance personnelle régulière, est d’office habilité à représenter la personne incapable de discernement.
Liste des proches
La loi va plus loin. Elle établit, par ordre de priorité, la liste des proches susceptibles d’endosser cette responsabilité. Après le conjoint et le partenaire enregistré, sont mentionnés: la personne qui fait ménage commun, les descendants, les père et mère, les frères et sœurs. A condition, toujours, qu’ils fournissent une assistance personnelle régulière au patient.
«Le législateur a ainsi renforcé l’autodétermination du patient et la mise à contribution des proches. En même temps, il souhaite par cette modification décharger un tant soit peu les autorités judiciaires d’une trop fréquente sollicitation dans des situations simples», commente Juliette Harari, conseillère juridique aux HUG.
Au niveau fédéral, le nouveau droit étend à l’ensemble des cantons les règles qui régissent les directives anticipées, en vigueur à Genève depuis 2007. Sur le plan civil, il permet à chacun de désigner un représentant pour l’administration de la vie courante. A défaut, la loi donne cette compétence au conjoint ou au partenaire enregistré.
«Un pas en avant»
«Le nouveau droit règle le problème des couples homosexuels. C’est excellent. En revanche, il n’assure pas automatiquement l’accès au dossier médical après le décès du patient», commente Anne-Marie Bollier, déléguée pour la Suisse romande et membre du comité de fondation de l’Organisation suisse des patients. Sur le plan fédéral, elle juge très favorablement l’extension à tous les cantons suisses des règles relatives aux directives anticipées. «C’est un grand pas en avant pour les patients et les proches de ce pays!», s’exclame-t-elle.
Pulsations - novembre-décembre 2012
Article original: http://bookapp.fr/api/hug/viewer/viewer.php?mag=HUGE_12B#5

Proches aidants: comment faire pour ne pas s’épuiser?

Aider un ou une proche concerne une personne sur quatre