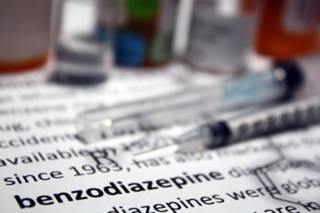Addictions : de nombreuses inégalités entre hommes et femmes

Si l’égalité entre femmes et hommes est un thème majeur au cœur de multiples préoccupations dans les domaines de la famille, de la formation ou encore du travail, les défis sont tout autres sur le plan biologique. En effet, une égalité « complète », à savoir l’absence de toute différence entre les sexes, y est impossible. En cause notamment : des différences immuables au niveau cérébral, endocrinien ou encore métabolique. Avec, de surcroît, l’influence considérable des facteurs socioculturels tels que le revenu, l’emploi ou les discriminations, hommes et femmes ne sont pas sur un pied d’égalité en matière de santé. Une réalité qui concerne aussi la consommation de substances.
Du côté des hommes
De manière générale, les hommes consomment plus que les femmes : deux fois plus d’alcool, de cannabis, de cocaïne ou d’opioïdes notamment. La consommation quotidienne (et donc excessive en elle-même) d’alcool concerne par ailleurs plus du double d’hommes que de femmes. À noter qu’à l’inverse, ces dernières sont plus nombreuses à ne pas boire d’alcool, avec une femme sur cinq abstinente. Les chiffres sont plus équilibrés concernant le tabac, mais on compte tout de même plus de fumeurs que de fumeuses.
Outre les risques pour la santé communs aux sexes (intoxication, cancers, maladies cardiovasculaires, etc.), ceux encourus en particulier par les hommes sont liés aux accidents et aux violences. Dans la population masculine, par exemple, 50 % des blessures suite à des actes de violence sont liées à l’alcool.
Par ailleurs, les hommes sont davantage exposés aux substances que les femmes et combinent donc souvent plusieurs consommations, par exemple alcool et tabac. Les risques pour leur santé ne sont alors pas simplement additionnés, ils sont multipliés.
Des vulnérabilités spécifiques aux femmes
Les différences de consommation entre les deux sexes s’expliquent par des raisons biologiques (poids, métabolisme, hormones), mais pas seulement. Le poids des normes sociales ainsi que la vulnérabilité des femmes face aux hommes, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles, contribuent aussi à accentuer ces inégalités.
Pendant longtemps, les femmes ont consommé beaucoup moins de substances que les hommes. Mais les évolutions sociétales des cinquante à soixante dernières années ont, petit à petit, réduit cet écart, surtout en matière de tabac et d’alcool, l’un et l’autre étant encore associés à une image de liberté et d’émancipation. Si, encore aujourd’hui, elles consomment moins que les hommes, les femmes sont néanmoins soumises à des attentes et à un jugement moral de la société qui peut accompagner les addictions d’un sentiment de honte et de culpabilité, les retenant de chercher de l’aide et d’accéder aux soins.
Sur le plan de la santé physique également, les femmes sont défavorisées. Pour des raisons hormonales, elles auront tendance à devenir – à consommation égale – plus rapidement dépendantes à une substance. En outre, parce que leur organisme absorbe différemment l’alcool et qu’il contient moins d’eau que le corps masculin, leur niveau d’alcoolémie peut être deux fois plus élevé que celui d’un homme pour la même quantité bue. Elles courent ainsi un risque accru de développer une cirrhose ou certains types de cancers provoqués par l’alcool.
Mais pour les femmes, un des plus grands risques liés aux substances est celui de la violence sexuelle. La consommation, indépendamment du sexe, augmente le risque de passages à l’acte, dont elles sont les principales victimes. De plus, sous l’influence de substances, les capacités à se défendre, à fuir ou à prendre des décisions éclairées sont réduites. Il est à rappeler qu’une personne semi-consciente ou inconsciente n’est pas en mesure de donner son consentement.
Adapter la prise en charge
Ces différences entre hommes et femmes doivent être prises en compte lors des bilans de santé afin d’améliorer la prévention, la détection précoce et le traitement des addictions et des risques qui en résultent. Pour les hommes, il est important de dénormaliser la consommation et de sensibiliser davantage aux dangers multiples des usages combinés de substances, notamment d’alcool et de tabac. Quant aux femmes, il est crucial de leur offrir un cadre de soins leur permettant de surmonter la stigmatisation en cas de consommation et portant une attention particulière aux risques de violences.
* Adapté deFavrod-Coune T., et al., Genres et consommation de substances : hommes exposés, femmes vulnérables. Rev Med Suisse. 2025; 21 (902): 97-101.
Alcool et grossesse : un risque sous-estimé
Boire de l’alcool pendant la grossesse, parfois même sans savoir qu’on est enceinte, expose le fœtus à des risques graves. L’alcool pénètre dans le système sanguin de l’enfant à naître dans une concentration qui atteint le même niveau que chez la mère. L’alcool étant toxique pour les cellules, il peut perturber le développement de tous les organes du fœtus. Le cerveau y est particulièrement sensible. Chaque année en Suisse, au moins 1700 nouveau-nés viennent au monde avec des dommages causés par une exposition prénatale à l’alcool (troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale). Face à ces chiffres, les spécialistes rappellent une règle simple : zéro alcool pendant la grossesse.